Balades nocturne à la quête du noir urbain
Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une recherche artistique plus large sur la dynamique sensible et politique des espaces publics durant la nuit. La recherche et le développement de ce projet ont consisté à conceptualiser l'obscurité non pas comme un vide, mais comme un espace de potentiel.


Au commencement de la résidence Design des Territoires au parc de La Villette, les échanges avec certains membres de l'équipe de direction ont mis en avant une orientation forte de l’établissement : transformer progressivement le parc en un refuge urbain pour la faune et la flore. À partir de cette idée, un premier axe de recherche s'est dessiné, centré sur l'étude du système d'éclairage public sur le site et de ses effets sur la biodiversité locale.
Progressivement, l’attention s’est déplacée de la seule question de l’éclairage vers une dimension plus conceptuelle et sensorielle : celle de l’obscurité en tant que phénomène spatial. Dans un premier temps, la réflexion s’est attachée aux bienfaits de l’obscurité pour les non-humains, avant de s’orienter vers une nouvelle direction : l’exploration des bénéfices que les êtres humains peuvent retirer de l’expérience de l’obscurité dans l’espace public.
Louis Aragon pendant ces balades nocturnes, décrivait le parc des Buttes-Chaumont comme le lieu où « s’est niché l’inconscient de la ville », renforçant l’idée de l’obscurité comme espace potentiel, traversé par l’imaginaire et l’inconscient collectifs.
Cette enquête a donné lieu à une série d'observations nocturnes individuelles menées sur place pendant l'automne et l'hiver, à toutes heures de la nuit. Permettant ainsi de cartographier les zones les plus sombres du parc, identifiées comme propices à une modification du rapport habituel au paysage urbain. Cette phase de dérive s’est accompagnée de lectures, parmi lesquelles Walkscapes de Francesco Careri (Stalker) et Le Paysan de Paris de Louis Aragon.


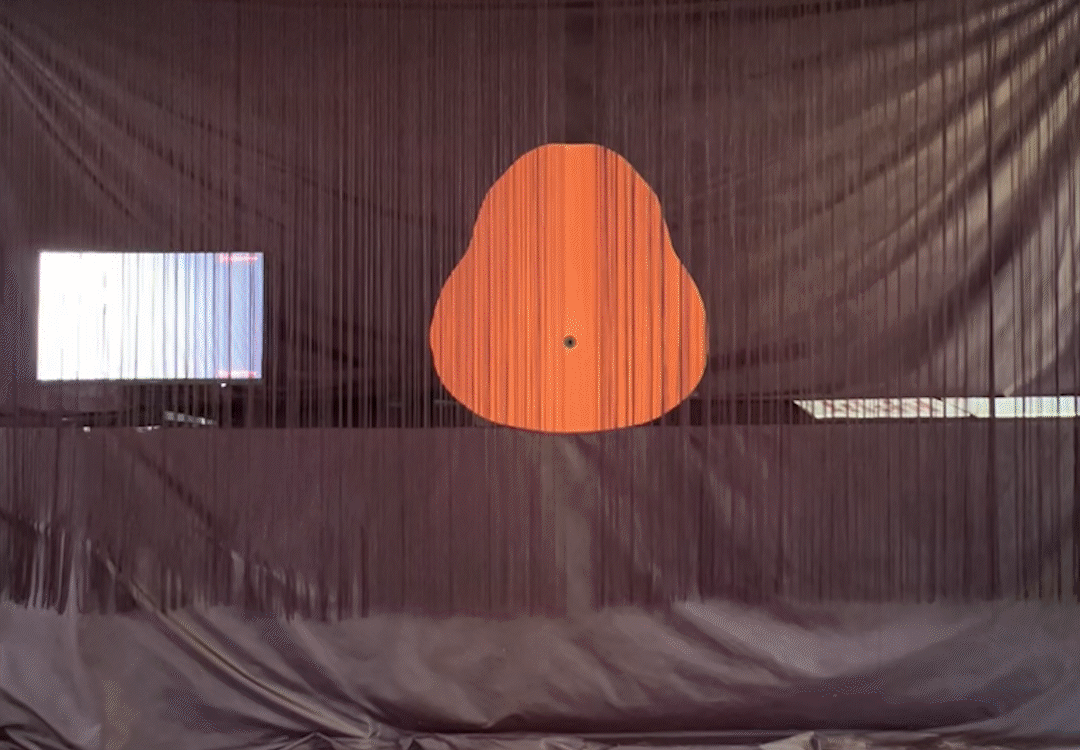
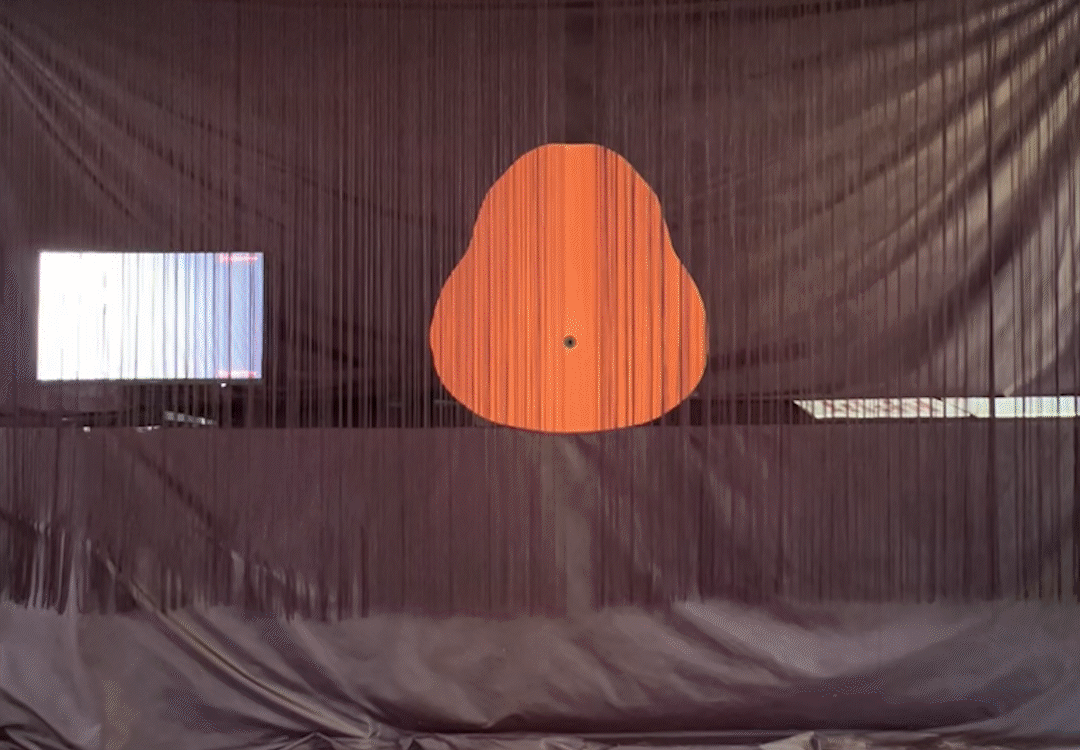
Les matériaux produits au cours de cette expérience ont nourri une installation présentée lors de la restitution finale aux Jardins Passagers.
La balade nocturne comme pratique d’observation et de relation avec la nuit urbaine a révélé l’obscurité comme espace potentiel, porteur de dimensions intimes, politiques et écologiques. Comme le suggérait Aragon en évoquant l’inconscient de la ville niché dans ses espaces nocturnes, une traversée collective de l’ombre ne vise pas à dissiper celle-ci, mais à en faire l’expérience en tant que ressource sensible et poétique offerte à l’espace public.


Certaines rencontres fortuites dans le parc ont mis en lumière les mécanismes de projection mentale déclenchés par l’expérience nocturne : l’inquiétude ne provient pas tant de la présence de l’autre que de la représentation élaborée dans le noir. La peur de la peur.
Dans le prolongement de cette recherche, une promenade nocturne collective a été organisée. Chaque participant était invité à faire un exercice d’esquisse visuelle et sensorielle permettant de conserver une trace des projections mentales suscitées par la traversée de l’obscurité.




Photos by David Aubriat
